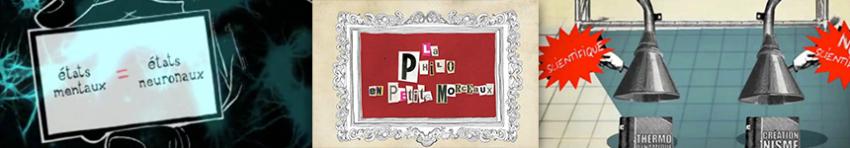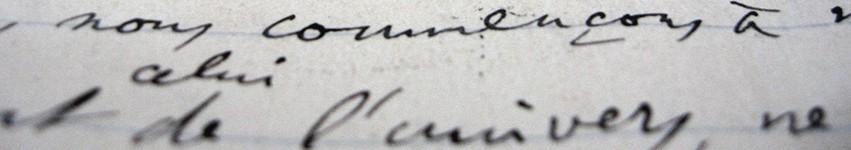La lettre d'information des Archives Henri-Poincaré d'avril 2024 est en ligne ! Cliquez ici pour la consulter. (Et les lettres précédentes sont à retrouver ici)
La lettre d'information des Archives Henri-Poincaré d'avril 2024 est en ligne ! Cliquez ici pour la consulter. (Et les lettres précédentes sont à retrouver ici)
| Les Archives Henri-Poincaré souhaitent exprimer leur solidarité avec les collègues de l'Université de Kent (UK) : beaucoup de départements, dont celui de philosophie, sont menacés de fermeture. Nous encourageons la communauté à manifester son soutien. Voir le texte de soutien sur X. |
Nouveau cadeau : nous vous offrons une visite virtuelle, celle de l'exposition Variations sur le paysage de Christophe Eckes, disponible sur e-MUSÉE, le musée numérique des BU de l'Université de Lorraine. Bonne visite ! (pour accéder à l'exposition sur le site de e-MUSÉE, c'est ici)